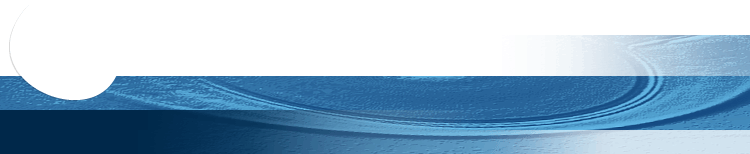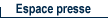Nouvelles publications scientifiques, créations de laboratoires, annonces de prix... Avec "En direct des labos", retrouvez toutes les deux semaines des informations issues des instituts du CNRS et complémentaires des communiqués de presse.
Institut des sciences biologiques (INSB)
Une nouvelle RNP 7SK régule la transcription de façon gène-spécifique
De nombreux ARN non-codants sont impliqués dans la régulation de l’expression des gènes. L’ARN 7SK, associé aux protéines Larp7 et MePCE au sein de la ribonucléoparticule RNP 7SK, contrôle l’activité d’un facteur général de transcription, P-TEFb. L’équipe de Tamás Kiss au Laboratoire de biologie moléculaire eucaryote, en collaboration avec celle de Shona Murphy à l’université d’Oxford, ont mis au jour une nouvelle fonction gène-spécifique de la RNP 7SK dans la régulation par l’ARN polymérase II. Cette étude a été publiée le 2 mars 2017 dans la revue EMBO Journal.
Première expérience métagénomique « 3D » sur un microbiome naturel complexe
La complexité des communautés microbiennes fait qu’il est difficile de caractériser les génomes des espèces qui les composent, ainsi que d’en suivre la dynamique au cours du temps. L’équipe de Romain Koszul, chercheur CNRS au département Génomes et génétique de l’Institut Pasteur, vient de démontrer que l’analyse des collisions physiques entre molécules d’ADN d’une population microbienne résout plusieurs des limitations techniques actuelles, permettant notamment d’identifier les hôtes bactériens de phages et plasmides de la population. Ces travaux ont été publiés le 17 février 2017 dans la revue Science Advances.
Le mécanisme de formation des cartes visuelles dans le cerveau enfin élucidé
La perception visuelle est le fruit d’un processus complexe d’analyse des informations qui requiert l’organisation précise de connections nerveuses. L'équipe de Michael Reber, à l'Institut des neurosciences cellulaires et intégratives, en collaboration avec le département de mathématiques de l’université de Cambridge et le département de neurobiologie moléculaire du Salk Institute (San Diego), a mis au jour et modélisé un mécanisme, jusque-là insoupçonné, de formation et d’alignement des cartes visuelles au sein d’une structure du cerveau, le colliculus supérieur, qui contrôle l’attention visuelle. Ces travaux, publiés le 14 mars 2017 dans la revue eLife, ouvrent de nouvelles perspectives dans l’étude de la formation des connections nerveuses sensorielles.
Les découvertes biomédicales rapportées par la presse sont-elles fiables ?
La recherche scientifique est un processus cumulatif évoluant d'une première étude incertaine vers un consensus stable au fur et à mesure des études sur une même question. Malheureusement, la presse couvre préférentiellement les études initiales et n'informe quasiment jamais le public lorsqu'elles sont invalidées, ce qui est pourtant le cas le plus fréquent. C'est ce que montrent Estelle Dumas-Mallet, du Centre Emile Durkheim, et ses collaborateurs à l'Institut des maladies neurodégénératives, en analysant la couverture médiatique de 4723 études associant un facteur de risque avec une pathologie. Cette étude est parue le 21 février 2017 dans la revue PLOS ONE.
Un cas d'immunité comportementale chez la drosophile
Les eucaryotes disposent d'un système immunitaire leur permettant d’éliminer les microorganismes pathogènes. Cette réponse antimicrobienne peut s'accompagner d'une immunité dite comportementale par laquelle l'hôte modifie son comportement pour minimiser l'impact de l'infection. L'équipe de Julien Royet à l'Institut de biologie du développement de Marseille, révèle les mécanismes par lesquels la détection d'un composant des bactéries par le système nerveux de la drosophile affecte son comportement. Cette étude a été publiée le 7 mars 2017 dans la revue eLife.
Institut de chimie (INC)
Du 2D au 3D : des designs innovants favorisent le stockage dans les batteries lithium-ion
Depuis quelques années, les chercheurs ont découvert que certains matériaux d'électrodes positives bénéficiaient d'un "bonus" de capacité de stockage grâce à l'activité d'espèces anioniques en supplément de l'activité des cations. Cette activité n'avait jusqu’à maintenant été prouvée que pour une classe précise de matériaux, des oxydes lamellaires dotés d’une structure bidimensionnelle (en 2D), qui présentent des performances encore limitées. Des chercheurs du Laboratoire chimie du solide et énergie ont observé pour la première fois cette activité dans des oxydes de structure tridimensionnelle (3D) bien plus favorable à la capacité de stockage. La richesse de la famille des oxydes tridimensionnels ouvre ainsi de nouvelles opportunités dans la recherche de nouveaux matériaux à capacité exacerbée pour les batteries du futur. Ces travaux sont publiés dans la revue Nature Materials.
Le silicium au coeur d'une nouvelle génération de composés à visée thérapeutique ?
Les hétérocycles sont très souvent présents dans de nombreux produits naturels qui relèvent de la chimie médicinale (comme par exemple la morphine). Cherchant à diversifier les propriétés de ces composés à base d’hétérocycles, une équipe du laboratoire « Chimie organique, bio-organique : réactivité et analyse » a mis au point une nouvelle voie de synthèse. Grâce à elle, ils sont parvenus pour la première fois à insérer un (puis deux) atome(s) de silicium dans les cycles de structures organiques originales. Ces résultats sont parus dans la revue Angewandte Chemie International Edition.
L'efficacité des pérovskites dans le photovoltaïque n'est pas un hasard
Des chercheurs de l’Institut des sciences chimiques de Rennes et du laboratoire Fonctions optiques pour les technologies de l'information, en collaboration avec des équipes américaines (Los Alamos, Northwestern, Brookhaven), viennent d'élucider l'origine des performances remarquables de dispositifs semiconducteurs à base de pérovskites lamellaires. Ces résultats font l’objet d’un article dans Science.
Des diodes électro-luminescentes à haut rendu de couleur
Les LEDs sont très souvent fabriquées à partir de composés contenant un ion terre rare comme l’europium (Eu) en très faible quantité. C’est cette terre rare qui contrôle les propriétés de luminescence. Des chercheurs de l’Institut des matériaux Jean Rouxel de Nantes ont développé une stratégie permettant de moduler le rapport « Eu3+/Eu2+ » pour obtenir une luminescence blanche optimale. Ces travaux sont publiés dans le Journal of the American Chemical Society.
Médicaments : pour une production éco-responsable à l'échelle industrielle
En cherchant à optimiser la synthèse d’intermédiaires clés dans l’obtention de composés à fort potentiel thérapeutique pour lutter contre la maladie d’Alzheimer ou la dépression, des chercheurs ont fait bouger les lignes. L’équipe "chimie verte et technologies innovantes" de l’Institut des biomolécules Max Mousseron, en collaboration avec des scientifiques de l’université de Cracovie, a en effet montré que la réaction pouvait s’opérer dans un solvant respectueux de l’environnement, tout en utilisant un appareillage de flux continu pour une montée en échelle vers la production industrielle. Ce travail, paru dans la revue Green Chemistry, devrait accélérer la mise au point et la commercialisation de nouveaux médicaments.
Institut écologie et environnement (INEE)
Les mammifères vivent en majorité plus longtemps en captivité
Il est couramment admis que les animaux vivent plus longtemps en captivité qu'à l'état sauvage. Famine, conditions climatiques extrêmes, prédation et compétition intra- et interspécifiques… les risques de mortalité prématurée dans la nature sont élevés. Pour autant, les rares études menées jusqu'à présent ne permettaient qu'une vision parcellaire, car elles se concentraient sur une espèce en particulier. Les récents travaux d’une équipe européenne composée de plusieurs chercheurs CNRS, publiés dans la revue Scientific Reports, sont les premiers réalisés à large échelle. Portant sur 59 espèces de mammifères répartis en 8 ordres (artiodactyles, périssodactyles, carnivores, primates, lagomorphes, rongeurs, diprotodontes et scandentiens), ils viennent confirmer que l'espérance de vie est supérieure en zoo pour 84 % des espèces de mammifères étudiées.
L'urbanisation affecte la croissance du moineau domestique
Pour les organismes vivants, l’urbanisation est synonyme de multiples contraintes par rapport au milieu rural. La conséquence est une biodiversité urbaine appauvrie, même si un petit nombre d'espèces s'est adapté. Chez les oiseaux, certaines espèces inféodées au milieu urbain semblent pourtant en déclin. C’est notamment le cas du moineau domestique (Passer domesticus), dont les populations ont chuté de 64 % en Europe depuis les années 1980. Les causes restant mystérieuses, une équipe de chercheurs du CNRS et du Muséum national d’Histoire naturelle a mené une étude pour évaluer dans quelle mesure la « qualité » des individus varie entre moineaux ruraux et urbains, en se basant sur des données concernant leurs plumes et leur morphologie. Ces données, collectées sur 30 sites de France métropolitaine par les bagueurs bénévoles du Centre de recherches sur la biologie des populations d’oiseaux, font de ce programme un bel exemple de sciences participatives. Les résultats, publiés dans la revue Landscape and Urban Planning, démontrent que les moineaux domestiques sont d’autant plus petits qu’ils vivent dans un milieu fortement urbanisé, et que la qualité du plumage des juvéniles est fortement altérée en milieu urbain. Des études supplémentaires sont désormais nécessaires afin de déterminer quels sont les facteurs de stress liés en milieu urbain qui affectent le plus l'espèce.
Une meilleure compréhension de la reproduction de l'olivier
La connaissance du mode de reproduction de l’olivier a connu récemment une avancée importante grâce à l'étude d'une espèce proche, la filaire. Chez la filaire, comme chez l’olivier, le risque d’incompatibilité entre le pollinisateur et les stigmates d’une plante est de l’ordre d’une chance sur deux. Cette découverte sur la reproduction de l’olivier pourrait expliquer les faibles rendements de certains vergers, d’après des travaux de chercheurs du CNRS, de l’université de Lille et d’équipes italiennes et marocaine, publiés récemment dans Evolutionary Applications.
La souris a colonisé nos maisons il y a 15 000 ans
L’impact de l’activité humaine sur la biodiversité est un phénomène écologique global qui touche quasiment tous les écosystèmes de notre planète. Mais les premières étapes de l’impact d’Homo sapiens sur son écologie demeurent mal connues et nécessitent une exploration fine du registre paléontologique et archéologique. En collaboration avec des collègues des universités d’Haïfa et de Jérusalem, des chercheurs du Muséum national d'histoire naturelle et du CNRS ont voulu savoir si, dans la trajectoire vers l’agriculture, la sédentarisation des sociétés de chasseurs-cueilleurs au Proche-Orient au cours du Paléolithique supérieur avait pu être le véritable catalyseur de l’émergence du commensalisme de la souris, plusieurs millénaires avant l’adoption du mode de vie agricole. Les résultats de cette étude ont été publiés dans la revue PNAS le 27 mars 2017.
L'histoire évolutive des espèces de Plasmodium précisée par la génomique
Depuis plusieurs années le génome de Plasmodium falciparum, principal agent responsable du paludisme, est scruté avec attention par la communauté scientifique. Ses cousins P. ovale et P. malariae restaient pour leur part peu étudiés sur le plan génétique alors qu’ils sont à l’origine de 5 % des cas de paludisme dans le monde. Grâce au séquençage complet du génome de ces deux espèces, une équipe du Centre Sanger de Cambridge (Royaume-Uni), à laquelle se sont associés des chercheurs du laboratoire Maladies infectieuses et vecteurs : écologie, génétique, évolution et contrôle, de Montpellier, a pu établir pour la première fois le cheminement évolutif des représentants du genre Plasmodium affectant l’homme et d’autres mammifères tels que les grands singes. L’étude, publiée dans Nature en janvier dernier, tend par ailleurs à montrer qu’une part importante des génomes de P. malariae et P. ovale sont impliqués dans les processus d’infection des cellules humaines.
Institut des sciences humaines et sociales (INSHS)
Magrit : un nouvel outil de cartographie en ligne
Magrit est une application de cartographie en ligne développée par le pôle géomatique du Réseau interdisciplinaire pour l'aménagement du territoire européen. Cet outil permet de réaliser des cartes thématiques d’une haute qualité graphique, directement dans un navigateur web, quel que soit le système d’exploitation (Mac OS, Windows, Linux…). En plus de proposer à l’utilisateur l’ensemble des représentations cartographiques classiques (cartes en proportion, cartes choroplèthes, typologies, etc.), l’application offre la possibilité de réaliser de nombreuses méthodes cartographiques souvent difficiles à mettre en œuvre dans les logiciels du marché : lissages, carroyages, discontinuités, anamorphoses, etc.
Institut des sciences de l'information et de leurs interactions (INS2I)
10 ans de l'ERC, témoignages de nos chercheurs
L'European Research Council (ERC) fête ses 10 ans en mars 2017. L'occasion de mettre en avant des chercheurs CNRS qui travaillent dans les laboratoires INS2I et de faire le point avec eux sur ce que leur a apporté l'aventure ERC.
- Pierre Comon : « La priorité dans une ERC est en réalité de nature sociale »
- Jean-Paul Laumond : « Une recherche libre, la seule qui permette la découverte et l’ouverture »
- Jean-Julien Aucouturier : « Ce qui restera de mon projet, ce sont les jeunes chercheurs formés »
- Iordanis Kerenidis : « L’expérience ERC est la plus enrichissante de ma carrière »
- Cédric Févotte : « Décrocher une ERC, c’est ouvrir une parenthèse enchantée »
- François Rousseau : « Remettre la science au cœur de notre métier »
Institut des sciences de l'ingénierie et des systèmes (INSIS)
Le plastique, c'est électromécanique
Très employés comme capteurs inertiels, dans les smartphones aussi bien que dans les manettes de jeux, les microsystèmes électromécaniques, ou MEMS, remportent un fort succès commercial. Généralement conçus en silicium, ils ne sont cependant pas toujours les mieux adaptés à des applications de capteurs chimiques et biologiques. Dans ce contexte, des chercheurs du laboratoire de l’Intégration du matériau au système ont réalisé des MEMS en matériaux polymères aux performances électromécaniques très prometteuses.
Les dessous de l'explosion spectaculaire d'une goutte d'eau et d'alcool
Si vous versez une petite goutte d’eau colorée et d’alcool sur un bain d’huile, elle éclate en une impressionnante myriade de gouttelettes. Des chercheurs du laboratoire de Physique et mécanique des milieux hétérogènes ont expliqué le phénomène par une brusque déstabilisation à la périphérie de la goutte. Ces travaux sont publiés dans la revue Physical Review Letters.
Un nouveau modèle pour mieux contrôler l'impression 3D des métaux
À partir de diverses poudres, le frittage sélectif par laser permet de façonner des objets à volonté. La complexité de la réaction des poudres métalliques lors de leur fusion affecte cependant la qualité de cette impression en 3D. Des chercheurs des laboratoires ICube, à Strasbourg et QEERI, au Qatar ont donc mis au point une simulation pour mieux comprendre et contrôler la distribution de la chaleur. Ces travaux sont publiés dans la revue Additive Manufacturing.
Quand la lumière s'auto-organise dans les fibres optiques
Si les fibres optiques multimodes permettent de transporter une grande quantité d’énergie, elles sont sujettes à des interférences qui nuisent à la qualité de la transmission d’informations. Des chercheurs du laboratoire XLIM, de l’ICB et de l’université de Brescia (Italie) ont démontré qu’augmenter la puissance de la lumière injectée entraîne son auto-organisation et réduit ces interférences. Ces travaux ont été publiés dans la revue Nature Photonics.
Institut national des sciences mathématiques et de leurs interactions (INSMI)
Une généralisation de la règle de Descartes
La règle de Descartes donne une majoration du nombre de racines strictement positive d'un polynôme à une variable donnée. La formulation d'une règle analogue dans le cas des polynômes à plusieurs variables a connu récemment un nouveau développement avec les travaux de Frédéric Bihan, du Laboratoire de mathématiques, et de sa collaboratrice. Dans un article des International Research Mathematics Notices, les deux auteurs proposent une majoration du nombre de racines dont toutes les coordonnées sont strictement positives.
Institut de physique (INP)
Des composants électroniques en germanène : vers une réalité
Des physiciens de l’Institut des matériaux, de microélectronique et des nanosciences et du Laboratoire de physique des interfaces et des couches minces au sein d’une collaboration internationale ont démontré qu’il était possible de garder intact les propriétés électroniques du germanène, cousin du graphène, en effectuant la croissance du germanène sur du graphite. Il est maintenant possible d’envisager la fabrication de composants électroniques fonctionnels à base de germanène.
Institut national de physique nucléaire et de physique des particules (IN2P3)
LHC : opération à coeur ouvert pour CMS
Début mars, la collaboration CMS a remplacé une partie du cœur de son détecteur : son système de trajectographie à pixels au silicium. Cette amélioration compte parmi les activités les plus importantes de CMS dans le cadre de l’arrêt technique hivernal prolongé du LHC. En France, l’Institut pluridisciplinaire Hubert Curien, à Strasbourg, est en première ligne pour la conception et l’installation de l’électronique d’acquisition de données de ce nouveau détecteur.
Une salle de contrôle de l'Observatoire Pierre Auger installée au LPSC
La première salle française de contrôle à distance des télescopes de fluorescence de l’Observatoire Pierre Auger, situé en Argentine, est entrée en service le 21 mars 2017 au Laboratoire de physique subatomique et de cosmologie, à Grenoble. Sa mise en œuvre réduit les coûts liés aux missions jusqu’alors nécessaires pour participer aux périodes de "shifts" à l’Observatoire. Et grâce au décalage horaire, le temps de travail nocturne des "shifters" en Argentine est réduit, les collaborateurs de l'IN2P3 prenant la relève dès potron-minet !
Aux limites de la cohésion de la matière
En 2016, une équipe de chercheurs du Centre d’études nucléaires de Bordeaux Gradignan, en collaboration avec des équipes internationales, ont découvert un nouvel isotope radioactif très rare : le 67Kr. Ce noyau de krypton possède la particularité de se désintégrer en émettant deux protons, un phénomène très rare prédit dès les années 1960. Ce résultat permet de mieux comprendre le comportement de la matière lorsqu’elle est poussée dans ses retranchements.
De nouveaux yeux pour l'expérience H.E.S.S.
Les caméras des quatre premiers télescopes de l’observatoire H.E.S.S. en Namibie ont vu leurs collecteurs de lumière gagner en efficacité et leur électronique de lecture rajeunir de plus de 15 ans afin de rejoindre les performances du cinquième télescope, beaucoup plus grand, installé en 2012. La mise en service de ces caméras aux performances et à la fiabilité améliorées, utilisant une technologie similaire à celle du futur Cherenkov Telescope Array (CTA), laisse présager de nouveaux résultats scientifiques pour H.E.S.S.
Institut national des sciences de l'Univers (INSU)
Le relevé APOGEE (SDSS-III) dévoile une population jeune dans le bulbe galactique
Au cours de la dernière décennie, des progrès significatifs ont été accomplis dans la compréhension du bulbe galactique. APOGEE (SDSS-III) était le premier relevé spectroscopique à large échelle en haute résolution de la population stellaire de la Voie lactée. APOGEE-2 va continuer à observer les parties internes de la Galaxie avec le télescope Irénée du Pont de l'Observatoire de Las Campanas, au Chili. Les premières observations d’APOGEE-2 ont été lancées en mars 2017. Une équipe internationale dirigée par des chercheurs de l’Institut Lagrange a montré dans ses derniers travaux, publiés le 21 mars 2017 dans Astronomy & Astrophysics, la performance du relevé APOGEE.
Observation de Beta Pictoris depuis l'Antarctique : l'aventure commence !
Avec l’arrivée de la nuit en Antarctique, les observations de l’étoile β Pic avec le télescope ASTEP viennent de débuter. Il s’agit d’observer un système composé d’une étoile très jeune et de sa planète géante, de tenter de découvrir des lunes ou des anneaux et au-delà, de résoudre un mystère : la variation de brillance de l’étoile observée en 1981 était-elle due au passage de la planète devant son étoile ? Pour la première fois, dans le cadre d’une collaboration internationale, un télescope va pointer cette étoile célèbre en continu, de mars à septembre 2017. Ceci n’est possible que parce que ce télescope automatique est localisé au milieu du continent Antarctique, et qu’il bénéficie donc d’une nuit presque continue lors de l’hiver austral. Les premières courbes de lumière de β Pic sont très prometteuses.
Le mystère des écoulements sombres équatoriaux de Mars s'éclaircit !
L'un des processus géomorphologiques les plus intrigants de Mars a été réinterprété. Les écoulements équatoriaux actifs de manière saisonnière, appelés Recurring Slope Lineae (RSL), ont été identifiés en 2011 et l'explication jusqu'alors avancée impliquait de l'eau liquide. La présence de ces RSL sur Mars était le principal argument de l'habitabilité actuelle sur la planète rouge. L'étude menée par une équipe internationale, dirigée par des chercheurs du laboratoire Géosciences Paris Sud et de l’Académie des sciences de Slovaquie, est basée sur des simulations numériques d'un processus exotique qui ne se produit qu'à très basse pression, comme sur Mars. Cette étude a été publiée en ligne par la revue Nature Geosciences le 20 mars 2017 et présentée au congrès international Lunar and Planetary Science Conference à Houston le 24 mars 2017.
Première découverte de l'oiseau géant crétacé Gargantuavis dans la péninsule ibérique
Gargantuavis philoinos est un oiseau terrestre géant initialement décrit à partir de différents éléments osseux découverts dans des sédiments du Crétacé supérieur dans le sud de la France. Un fossile découvert dans le gisement Campanien supérieur (Crétacé supérieur) de Laño, dans le nord de l’Espagne, en tout point comparable aux spécimens découverts en France, constitue le premier spécimen rattaché à cette espèce découvert hors de France. Cette découverte, due à un groupe de chercheurs basés en Afrique du Sud, en France et au Pays basque espagnol, augmente la diversité de l’assemblage fossile de Laño et l’aire de répartition de cet oiseau encore mal connu, qui vivait sur l’île ibéro-armoricaine, incluant à l'époque une partie de la France et la péninsule ibérique.
Récent séisme en Nouvelle-Zélande : une cascade de ruptures sur différentes failles
L’analyse des données sismologiques globales du récent séisme de Kaikoura (Nouvelle-Zélande, 13 novembre 2016) et la réalisation de simulations numériques fines ont permis à deux chercheurs de l’Institut de physique du globe de Strasbourg de révéler une interaction complexe entre différentes failles, lesquelles ont rompu successivement avec différentes orientations et différents sens de glissement. Cette série de ruptures montre qu’une petite rupture intra-plaque peut déclencher un fort glissement au niveau de la zone de subduction, ce qui renverse la vision classique des interactions entre failles autour d’une zone de subduction.
Directeur de la publication : Alain Fuchs
Directeur de la rédaction : Brigitte Perucca
Responsable éditorial : Julien Guillaume
Secrétaire de rédaction : Priscilla Dacher, Véronique Étienne, Alexiane Agullo
Comité éditorial : Christophe Cartier Dit Moulin, Stéphanie Younès (INC) ; Clément Blondel, Mounia Garouche (INEE) ; Jean-Michel Courty, Marie Signoret, Marine Charlet-Lambert (INP) ; Clotilde Fermanian, Pétronille Danchin (INSMI) ; Lisa Maymon, François Mercier, Perrine Royole-Degieux (IN2P3) ; Jean-Antoine Lepesant, Conceicao Silva, Jeremy Zuber, Marina da Silva Moreira (INSB) ; Armelle Leclerc (INSHS) ; Muriel Ilous, Chloé Rimailho (INSIS) ; Laure Thiébault (INS2I) ; Dominique Armand, Géraldine Gondinet, Kelly Will (INSU).