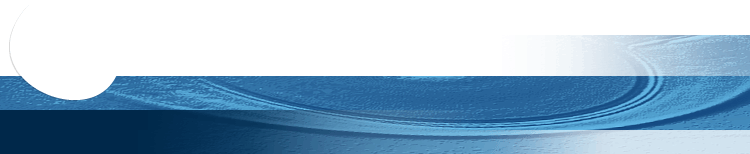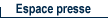Nouvelles publications scientifiques, créations de laboratoires, annonces de prix... Avec "En direct des labos", retrouvez toutes les deux semaines des informations issues des instituts du CNRS et complémentaires des communiqués de presse.
Institut des sciences biologiques (INSB)
Pourquoi les doses faibles de médicaments anticancéreux pourraient être plus efficaces ?
Les équipes de Daniel Fisher, à l’Institut de génétique moléculaire de Montpellier, et de Michael Hochberg à l’Institut de sciences de l’évolution de Montpellier, apportent la première validation expérimentale du concept de la “thérapie adaptative” fondée sur les principes de l’évolution darwinienne. Cette stratégie thérapeutique émergente repose sur l’idée, non encore validée, que l’administration de doses réduites d’anticancéreux qui arrêtent la prolifération des cellules cancéreuses, pourrait se révéler plus efficace en maintenant une compétition entre cellules sensibles et résistantes à la chimiothérapie. Cette étude, publiée le 8 décembre 2017 dans la revue Nature communications, confirme ce principe en démontrant que l’efficacité des régimes de thérapie adaptative dépend de la compétition spatiale au sein des tumeurs.
Cumul d’activités pour l’exosome
L’exosome est un facteur clé de la dégradation des ARN chez les eucaryotes. L’équipe de Dominique Gagliardi, à l'Institut de biologie moléculaire des plantes, a identifié une activité catalytique inédite de l’exosome chez Arabidopsis, qui n’existe ni chez la levure, ni chez l’homme. Cette activité a la particularité d’être réversible : elle peut soit dégrader des ARN, soit synthétiser des extensions ribonucléotidiques. Cette propriété catalytique de l’exosome semble conservée dans toute la lignée verte, et pourrait également exister chez d’autres eucaryotes comme un pathogène humain, l'amibe Naegleria fowleri. Cette étude a été publiée le 18 décembre 2017 dans la revue Nature Communications.
Le chromosome bactérien sert à l’assemblage des complexes protéiques signalétiques
Des chercheurs du Laboratoire de chimie bactérienne dévoilent de nouvelles fonctions du chromosome bactérien dans l'organisation de la cellule en démontrant que chez Myxococcus xanthus, le chromosome sert de plateforme pour l’assemblage de complexes signalétiques qui coordonnent le mouvement des bactéries en réponse à l’environnent. L'association de ces complexes avec l’ADN permet une réponse rapide et sensible des bactéries aux stimulations. Cette étude a été publiée le 21 novembre 2017 dans la revue PLOS Genetics.
Comment le cerveau retrouve son chemin sans fil d’Ariane
Retrouver son chemin dans une ville où toutes les rues se ressemblent, c’est comme sortir d'un labyrinthe sans aucun repère : on ne peut compter que sur une connaissance précise du trajet à suivre et des choix à faire à chaque intersection : "prendre la première à gauche, la deuxième à droite…". Des chercheurs du laboratoire Neurosciences Paris-Seine, en collaboration avec une équipe de l’Institut des systèmes intelligents et de robotique, ont couplé imagerie cérébrale chez la souris et modélisation mathématique afin de déterminer l’architecture cognitive impliquée dans l’apprentissage d’une telle séquence. Ils ont ainsi identifié le rôle central de l'hippocampe et du cervelet dans la capacité à mémoriser son chemin vers un but lorsque les informations visuelles sont ambiguës. Cette étude a été publiée le 19 décembre 2017 dans la revue Scientific Reports.
Lymphocytes T : bien connaître l’organisme pour mieux le protéger
Au cours de leur génération dans le thymus, les lymphocytes T sont sélectionnés pour leur auto-réactivité, c’est à dire leur capacité à reconnaître, grâce à un récepteur spécifique exprimé à leur surface, les peptides issus des protéines du soi en association avec les molécules du complexe majeur d’histocompatibilité. Des chercheurs de l’Institut Cochin décryptent les mécanismes qui préviennent les risques d’auto-immunité en orientant la différenciation des lymphocytes T les plus auto-réactifs vers un destin de cellules suppressives de la réponse immune. Cette étude a été publiée le 14 décembre 2017 dans la revue eLife.
Institut de chimie (INC)
Interaction ADN/électron : des réactions ultra-rapides visualisées pour la première fois
Une équipe du Laboratoire de chimie physique, en partenariat avec l’Université d’Oakland, vient d’élucider une des réactions ultrarapides résultant de l’exposition de l’ADN à un rayonnement ionisant, en milieu aqueux. Grâce à une technique sophistiquée alliant impulsion et sonde, les chercheurs ont pu observer qu’un électron libéré par le rayonnement peut, avant de s’hydrater, s’attacher à une base de l’ADN, sans la dissocier et mille fois plus vite qu’un électron hydraté. Des résultats à retrouver dans la revue Science Advances.
Chimie durable : un congrès pour "booster" l'éco-conception
Réunir les plus éminents scientifiques de la chimie durable pour faire accélérer l’émergence de solutions éco-conçues, toujours plus performantes et respectueuses de l’environnement : c’est l’ambition de l’International Symposium of Green Chemistry, l’ISGC. Pensé comme une plate-forme interdisciplinaire, l’ISGC décloisonne les sphères publiques et privées et offre aux scientifiques l’opportunité de partager leurs connaissances, de la recherche fondamentale jusqu’au développement industriel. Tous les deux ans, des centaines d’experts sont ainsi invités à échanger et débattre des futurs défis de la chimie. François Jérôme, directeur de la fédération Increase qui pilote aujourd’hui l’organisation de l’événement, nous éclaire sur les ambitions de ce rendez-vous résolument tourné sur l’innovation collaborative public/privé.
Raphaël Rodriguez, un chercheur français à l’accent très british !
Raphaël Rodriguez, jeune directeur de recherche au CNRS, vient d’être nommé « Fellow of the Royal Society of Chemistry » de Londres pour l’excellence de ses travaux à l’interface de la chimie et de la biologie du cancer. Ce brillant chimiste, dont l’équipe est localisée au Laboratoire chimie biologique des membranes et ciblage thérapeutique, a intégré la promotion 2017 du Young Leaders Franco-Britannique.
Des aimants liquides
Des chercheurs de l’Institut de chimie de Strasbourg et de l’Institut de physique et chimie des matériaux de Strasbourg viennent de mettre au point des matériaux magnétiques liquides, et donc purs, à basse température (70°C). Les propriétés ferro- et antiferromagnétiques sont observées dans les solides et jusqu’à présent, seules des solutions ou des suspensions présentant des propriétés magnétiques diluées avaient été préparées. Ces sels, à bas point de fusion, allient les propriétés des liquides ioniques à celles des complexes moléculaires ferro- ou antiferromagnétiques. Cette première fait l’objet d’une parution dans le Dalton Transactions.
Institut des sciences humaines et sociales (INSHS)
Quelle place pour les plateformes de crowdfunding dans l’action publique ?
Chargée de recherche CNRS au sein de TSM-Research, Héloïse Berkowitz analyse le rôle de l’action collective entre plateformes de crowdfunding dans la définition du cadre règlementaire pour le secteur du financement participatif. Cette étude, menée avec Antoine Souchaud ̶ membre de ESCP Europe et du Labex ReFi ̶ a donné lieu à la publication d’un article dans le dernier numéro de la revue Politiques et Management Public.
Institut des sciences de l'information et de leurs interactions (INS2I)
Jean-Paul Laumond élu à l’Académie des sciences
Jean-Paul Laumond a été élu le 5 décembre 2017 membre de l’Académie des sciences. Il a contribué à jeter les bases de la planification du mouvement en robotique en mettant en œuvre des techniques issues de disciplines variées (théorie des graphes, géométrie algorithmique, automatique, algorithmes probabilistes et neurosciences).
Institut des sciences de l'ingénierie et des systèmes (INSIS)
Des capteurs de gaz à base de nitrure de gallium transférés sur un support flexible
Des capteurs de gaz à base de nitrure de gallium, réalisés sur un substrat en saphir, ont été transférés sur des feuilles métalliques ou polymères souples. Ce transfert a pour effet de doubler la sensibilité du capteur aux oxydes d'azote (NOx). Il permet un temps de réponse six fois plus rapide et ouvre la voie à des applications environnementales, portables et à bas coût. Ces résultats sont publiés par des chercheurs du laboratoire GeorgiaTech-CNRS dans Scientific Reports.
Un composant térahertz pour manipuler les réseaux sans fil mille fois plus rapides
L’explosion des réseaux sans fil pousse les technologies actuelles dans leurs retranchements. Si les fréquences térahertz offrent des débits suffisants, elles manquent encore de composants adaptés à leur mise en œuvre. Des chercheurs de l’IEMN et de la Brown University de Providence (USA) ont donc conçu et testé le premier système mux/demux fonctionnant à ces fréquences. Cet élément permet de « zapper » entre différents flux et d’atteindre un débit mille fois supérieur au Wi-Fi. Ces travaux sont publiés dans la revue Nature Communications.
Institut de physique (INP)
Pourquoi la chantilly retombe-t-elle ?
La crème Chantilly ou la mousse de bitume sont deux exemples de mousses complexes, des mousses d’émulsion, qui ne sont pas stables au cours du temps. Dans ces systèmes, à la fois la mousse et l’émulsion sont susceptibles de vieillir. Leur évolution couplée, au cours du temps, a été caractérisée par une équipe du Laboratoire de physique des solides. Leurs travaux ont été publiés dans la revue Soft Matter.
Friction solide sur des supports... pas très solides
Les lois de la friction solide supposent que les corps en présence sont effectivement solides. En observant des fourmis à la surface de milieux sablonneux, des chercheurs ont posé la question de la validité de ces lois dans le cas de milieux partiellement solides. Alors que les objets lourds génèrent des déformations en forme d’empreinte qui stabilisent les objets sur les pentes, les objets légers ne perturbent pas les surfaces sableuses et sont également stables. Pour les poids de corps intermédiaires, les déformations de la surface déstabilisent les objets et génèrent un glissement.
Un nouveau mécanisme de refroidissement ultra-efficace pour les transistors de graphène
Des physiciens viennent de mettre en évidence un nouveau mécanisme de refroidissement pour les composants électroniques en graphène déposés sur du nitrure de bore. L’efficacité de ce mécanisme leur a permis d’atteindre pour la première fois des intensités électriques à la limite intrinsèque de conduction du graphène.
Une cartographie des effets quantiques pour optimiser la mobilité dans les semi-conducteurs organiques
Le contrôle des effets de localisation quantique des électrons pourrait permettre d’améliorer les performances des semi-conducteurs organiques pour l’électronique, ouvrant la voie à des applications inédites. Les chercheurs sont parvenus à indiquer clairement où chercher les bons arrangements moléculaires dans ces matériaux, là où il fallait auparavant tester différentes cristallisations possibles de forme aléatoire. Leurs résultats permettent ainsi de rationaliser la recherche de nouveaux composés. Ces travaux sont publiés dans la revue Nature Materials.
Des électrons fortement corrélés dans un résonateur micro-onde de grande finesse
En couplant une boîte quantique constituée d’un nanotube et d’un résonateur micro-onde, des physiciens ont pour la première fois accédé à la dynamique de l’effet Kondo. Ils ont montré que dans ce système, le transport des électrons repose uniquement sur les corrélations dans le nuage électronique.
Institut national de physique nucléaire et de physique des particules (IN2P3)
L’axion échappe encore une fois aux observations
Une collaboration internationale, à laquelle participent le LPCC, le LPSC et le CSNSM, a mené une expérience de laboratoire qui pour la première fois contraint le couplage entre l’axion et les gluons confinés dans des neutrons. La très haute sensibilité du spectromètre nEDM (Neutron Electric Dipole Moment) dédié à la mesure du moment électrique dipolaire du neutron, a permis de repousser les contraintes d’origine astrophysique d’un facteur 1 000, réduisant le champ des possibles pour cette particule.
Institut national des sciences de l'Univers (INSU)
Un subtil point de basculement chimique régit le style d'éruption des magmas rhyolitiques
Des chercheurs de l’université de Bristol, de l’université de Munich et de l’Institut de physique du globe de Paris viennent de révéler que des changements se produisant à une échelle nanoscopique dans un magma rhyolitique peuvent provoquer des modifications catastrophiques dans la dynamique des éruptions volcaniques qui peuvent alterner entre des éruptions effusives et explosives.
Confirmation expérimentale de la fusion partielle du manteau terrestre profond
La structure et la dynamique interne de la Terre ont un fort impact sur les phénomènes géologiques se produisant à la surface du globe, comme le volcanisme et la tectonique des plaques. Depuis plusieurs années, certains modèles proposent la présence de magmas à plusieurs centaines de kilomètres de profondeur dans le manteau terrestre. Or des chercheurs du Laboratoire magmas et volcans et de la Case Western Reserve University (USA) viennent de reproduire expérimentalement la fusion partielle des roches mantelliques aux conditions régnant à la base du manteau supérieur, entre 350 et 410 km de profondeur, soit 12-15 GPa, environ 1 400°C et en présence d’un peu d’eau. Pour la première fois, ils ont pu observer in situ l’effet de la fusion sur la vitesse de propagation des ondes sonores et la conductivité électrique. Les signaux qu’ils ont mesurés sont tout à fait compatibles avec les mesures géophysiques, ce qui confirme la présence d'une fine couche partiellement fondue à ces profondeurs, dans le manteau.
Désoxygénation de l’océan : une grande étude en révèle les dangers et les solutions
Au cours des cinquante dernières années, la proportion de zones de haute mer dépourvues de tout oxygène a plus que quadruplé. Quant aux sites à faible teneur en oxygène situés près des côtes, y compris les estuaires et les mers, ils ont été multipliés par dix depuis 1950. Les scientifiques estiment que la teneur en oxygène continuera à chuter dans ces deux types de zones au fur et à mesure que la Terre se réchauffera. Les chercheurs du groupe de travail international Global Ocean Oxygen Network mis en place par l’Unesco et comprenant un chercheur du Laboratoire d’études en géophysique et océanographie viennent de démontrer que pour mettre un terme à ce déclin, il est nécessaire de limiter le changement climatique et la pollution par les nutriments.
Voyage au centre d'une étoile naine blanche
Un cœur stellaire défiant les prédictions : voici ce que dévoile la première cartographie de l'intérieur d'une étoile naine blanche réalisée par une équipe internationale menée par une jeune chercheuse de l'Institut de recherche en astrophysique et planétologie. Cette avancée permettra de mieux comprendre les mécanismes physiques impliqués dans l'évolution des étoiles et de notre Soleil. Ce résultat est publié dans la revue Nature du 8 janvier 2018.
La turbulence des ondes gravitationnelles dans l’Univers primordial
La possibilité de détecter directement les ondes gravitationnelles laisse présager d’importantes découvertes sur le fonctionnement de notre Univers. Deux chercheurs du Laboratoire de physique des plasmas et de l’université de Warwick soulèvent un coin du voile sur la physique à l’œuvre dans l’Univers très primordial en parvenant à décrire le comportement non-linéaire des ondes gravitationnelles. Ces travaux sont publiés dans la revue Physical Review Letters.
Directeur de la publication : Anne Peyroche
Directeur de la rédaction : Brigitte Perucca
Responsable éditorial : Julien Guillaume
Secrétaires de rédaction : Priscilla Dacher, Véronique Étienne, Alexiane Agullo, Fabienne Arpiarian
Comité éditorial : Christophe Cartier Dit Moulin, Stéphanie Younès (INC) ; Elodie Vignier (INEE) ; Jean-Michel Courty, Marie Signoret, Marine Charlet-Lambert (INP) ; Clotilde Fermanian, Pétronille Danchin (INSMI) ; Lisa Maymon, François Mercier, Perrine Royole-Degieux (IN2P3) ; Jean-Antoine Lepesant, Conceicao Silva, Jeremy Zuber, Marina da Silva Moreira (INSB) ; Armelle Leclerc, Nacira Oualli (INSHS) ; Muriel Ilous, Chloé Rimailho (INSIS) ; Laure Thiébault (INS2I) ; Dominique Armand, Géraldine Gondinet (INSU).