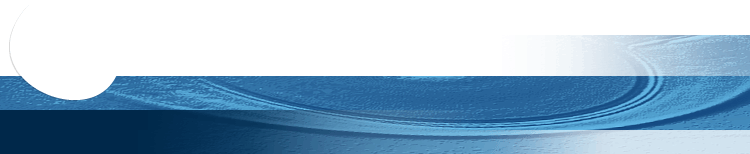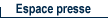Nouvelles publications scientifiques, créations de laboratoires, annonces de prix... Avec "En direct des labos", retrouvez toutes les deux semaines des informations issues des instituts du CNRS et complémentaires des communiqués de presse.
Institut des sciences biologiques (INSB)
Un éclairage nouveau sur la synthèse d’un polysaccharide essentiel
Des scientifiques fournissent pour la première fois un aperçu moléculaire de la biosynthèse des chaînes d’héparanes sulfates, polysaccharides complexes de grande taille qui ornent la surface des cellules humaines. Publiée dans Nature Communications, cette étude dévoile la structure et la fonction d’un complexe enzymatique qui réalise la phase d’élongation, étape centrale de la biosynthèse des héparanes sulfates. Ces données pourraient faciliter le développement de nouvelles approches thérapeutiques pour traiter les nombreuses pathologies impliquant les ligands protéiques des héparanes sulfates, comme le cancer ou les infections virales.
Organoïdes cérébraux et réponse au stress dans les troubles du neurodéveloppement
Le grand nombre et l’hétérogénéité des troubles du neurodéveloppement (TND) sont un frein majeur au développement de thérapies. Récemment, des traits communs ont été identifiés tels que des signatures épigénétiques et de réponse au stress cellulaire aberrantes. Publiés dans Nature Communications, des travaux menés sur des organoïdes montrent que l’activité anormale de la voie de stress HSF n’est pas limitée aux TDN dus à un stress prénatal, mais s’étend aussi à des TND d’origine génétique, ouvrant la possibilité d’en faire une cible de futures stratégies thérapeutiques.
Institut de chimie (INC)
Le transfert magnétoélectrique d’un motif de domaine pour la protection des données numériques
Des scientifiques viennent de faire basculer un "motif de domaine", élément de base du stockage de l’information binaire, d’un état magnétique vers un état électrique. Ce résultat ouvre des perspectives pour l’encodage et la sécurisation des informations numériques, en la rendant par exemple indétectable par la présence de champs magnétiques externes.
Des catalyseurs off/on à base de caténanes
Inspirés par les travaux de Jean-Pierre Sauvage, prix Nobel de chimie en 2016, des chimistes ont conçu des catalyseurs originaux activables "à la demande". Ces systèmes moléculaires à base de caténanes de cuivre auto-immolables, c’est-à-dire qui s'ouvrent de manière contrôlable, sont présentés dans la revue Angewandte Chemie International Edition.
Une corbeille moléculaire tout en lumière
L’utilisation de la lumière pour initier des réactions est une des pistes très prometteuses pour diminuer l’empreinte carbone de la chimie. Dans une étude parue dans la revue Angewandte Chemie International Edition, des scientifiques présentent des complexes de cuivre luminescents stabilisés par un ligand qui permet d’optimiser leurs propriétés en formant une corbeille moléculaire. Ces complexes pourraient bien remplacer les photocatalyseurs actuels à base de métaux nobles.
Peindre des nanofilms de collagènes pour créer des tissus musculaires
Le traitement ou remplacement de tissus musculaires malades ou endommagés pourrait bien être impacté par une nouvelle technique de peinture proposée par des scientifiques du CNRS et de l’Inserm. En alignant des couches nanométriques de collagène avec un simple pinceau, ils sont parvenus à guider la croissance et la différentiation de cellules souches des muscles en fibres musculaires. Une étude qui est parue dans ACS Nano.
Institut écologie et environnement (INEE)
Les vieux arbres sont plus résistants mais moins résilients à la sécheresse
Chaque épisode de sécheresse affaiblit et ralentit la croissance des arbres de nos forêts. Mais leur sensibilité à la sécheresse évolue-t-elle avec l’âge ? Une équipe internationale vient de répondre à cette question dans Nature Climate Change. Les résultats montrent une baisse de la croissance radiale plus forte chez les jeunes arbres adultes que chez leurs aînés qui sont plus résistants au cours d'une année de sécheresse. Néanmoins, la reprise de la croissance radiale, dans les années qui suivent un tel épisode, est plus rapide chez les jeunes arbres adultes qui sont donc plus résilients.
Des pollinisateurs clés pour l’agriculture, mais très largement négligés
Le lien entre abeilles et pollinisation des cultures n’est plus à démontrer. Mais de nombreux autres pollinisateurs moins connus participent à ce phénomène essentiel pour la sécurité alimentaire. Une équipe de recherche internationale passe en revue, dans Trends in Ecology and Evolution, des études originales sur le sujet et met en évidence le rôle clé de ces organismes autres que les abeilles, mais cependant peu considérés actuellement dans les études sur la pollinisation.
Entre humains et nature : la distance augmente
Une étude, publiée dans la revue Frontiers in Ecology and the Environment par une équipe franco-allemande, révèle que de nombreuses interactions avec la nature sont en déclin à travers le monde. Les scientifiques mettent en évidence une distanciation grandissante entre nos lieux de vie et les espaces naturels, et synthétisent les connaissances actuelles sur l’évolution récente des interactions Homme-nature. Ils appellent à une meilleure considération individuelle et institutionnelle de l’importance de ces interactions dans la protection de la biodiversité.
Institut des sciences de l'information et de leurs interactions (INS2I)
Trois chercheurs du LS2N parmi les plus cités depuis 1990 dans la revue Mechanism and Machine Theory
Les mécanismes des robots sont étudiés de très près à Nantes depuis plus de 30 ans. De la théorie aux applications industrielles, une véritable "école nantaise" s’est progressivement mise en place autour de Stéphane Caro, Damien Chablat et Philippe Wenger, tous trois chercheurs du CNRS au Laboratoire des sciences du numérique de Nantes. Ils font aujourd’hui partie des 30 auteurs les plus cités depuis 1990 dans la prestigieuse revue scientifique Mechanism and Machine Theory.
ERC : des IA pour faciliter l’analyse de données historiques et d’images satellites
Parmi les dernières annonces des bourses ERC Starting Grant, Mathieu Aubry du Laboratoire d'informatique Gaspard-Monge pilotera Discover. Ce projet de vision assistée par ordinateur ambitionne de développer des méthodes d’apprentissage non supervisé pour identifier les motifs répétitifs et leurs éventuelles transformations au sein de divers types de documents et d’images.
Clémentine Maurice, femme cyber chercheuse de l’année 2022
Tous les ans, à l’occasion de la journée européenne des femmes en cybersécurité (European Cyber Women Day), des femmes qui travaillent dans ce domaine sont récompensées. Cette année, Clémentine Maurice, chercheuse du CNRS au Centre de recherche en informatique, signal et automatique de Lille, reçoit le trophée de la femme cyber chercheuse. À l’occasion de cette distinction, elle fait le point sur ses travaux.
Une Étoile de l’Europe pour la robotique humanoïde
Nicolas Mansard, chercheur du CNRS au Laboratoire d’analyse et d’architecture des systèmes, veut développer une méthode universelle pour contrôler les robots humanoïdes, quels que soient leurs caractéristiques, l’environnement et les tâches qu’ils doivent effectuer. Cette ambition se manifeste notamment dans le cadre du projet européen Memmo, grâce à une banque de mouvements et des algorithmes qui décident et améliorent en temps réel les mouvements des robots. Une Étoile de l’Europe vient de lui être remise pour ce projet.
Simulation de réseaux de neurones bio-inspirés : vers une intelligence artificielle frugale
Alexandre Muzy, chercheur du CNRS au laboratoire Informatique, signaux et systèmes de Sophia-Antipolis, a réussi à simuler un réseau de neurones de taille équivalente au cerveau d’un petit singe sur un simple ordinateur de bureau. Ces travaux, publiés dans la revue Neural Computation, offrent de nouvelles perspectives au développement d’algorithmes d’apprentissage automatique plus économes en énergie.
Institut de physique (INP)
La reconnexion magnétique étudiée en laboratoire
Dans de nombreux processus astrophysiques comme les éruptions solaires, l'accélération des particules résulte vraisemblablement de la reconnexion entre différentes lignes de champ magnétiques. Des scientifiques ont montré que la géométrie de ces lignes de champ joue un rôle crucial. Leurs travaux sont publiés dans Nature Communications.
L’étalement languide des gouttes critiques
Des physiciens ont étudié le processus d’étalement sur un solide d’une goutte quasi-critique, un état de la matière où les distinctions entre les deux fluides que sépare la surface de la goutte s’estompent, permettant de tester l’universalité des modèles physiques décrivant le processus de mouillage. Ces travaux sont publiés dans Nature Communications.
Institut national des sciences de l'Univers (INSU)
Les grands filaments de la toile cosmique brillent dans les premières données du relevé eRosita
Un nouvel éclairage sur la matière cachée dans l’Univers a été donné par l’analyse statistique des premières données du satellite SRG/eRosita qui observe dans les rayons X. Une promesse de nouvelles découvertes lorsque l’ensemble des données sera publié !
Cartographie de la chimie du manteau terrestre
Des scientifiques ont cartographié la chimie du manteau terrestre à l’échelle globale. Les résultats suggèrent que la composition actuelle du manteau (410 à 660 km de profondeur) est le résultat de plusieurs cycles de subduction, de ségrégation et d’accumulation.
La lune martienne Phobos réfléchit-elle les protons du vent solaire ?
La surface de la Lune en orbite autour de la Terre agit comme un miroir qui réfléchit dans l'espace environ 1 % des protons incidents. Pour comprendre le phénomène de réflexion du vent solaire, une équipe a essayé de caractériser celui-ci à un autre corps céleste : la petite lune Phobos qui orbite autour de la planète Mars.
Swot : un satellite pour cartographier le cycle de l’eau sur Terre
Le satellite de la mission Swot a été lancé en orbite autour de la Terre le 15 décembre 2022. Il a pour objectif de cartographier le cycle de l'eau à l'échelle planétaire, avec un niveau de précision jamais atteint auparavant. Découvrez les enjeux et les technologies qui se cachent derrière ce satellite innovant !
Directeur de la publication : Antoine Petit
Directeur de la rédaction : Jérôme Guilbert
Responsable éditoriale : Priscilla Dacher
Secrétaire de rédaction : Fabienne Arpiarian
Comité éditorial : Christophe Cartier Dit Moulin, Anne-Valérie Foillard-Ruzette, Stéphanie Younès (INC) ; Simon Fretel, Floriane Vidal (INEE) ; Jean Farago, Séverine Martrenchard, Vincent Planchenault, Linda Salvaneschi, Marie Signoret (INP) ; Emmanuel Royer (INSMI) ; Jennifer Grapin, Emmanuel Jullien, Perrine Royole-Degieux (IN2P3) ; Mathilde Ananos, Aurélie Meilhon, Pierre Netter, Nicolas Plantey (INSB) ; Armelle Leclerc, Marie Mabrouk, Nacira Oualli (INSHS) ; Marine Charlet-Lambert, Chloé Rocheleux (INSIS) ; Margot Durand, Estelle Hutschka, Laure Thiébault (INS2I) ; Anne Brès, Léa Lahmar (INSU).