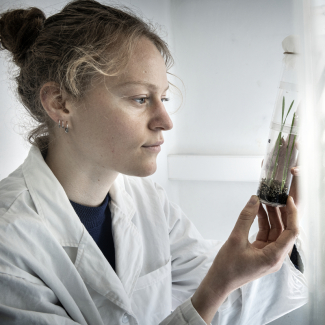
Sciences 2024 : la recherche vise l’or aux JO
Lancé le 4 septembre 2018 avec pour ambition d’accroître les performances des sportifs français aux Jeux olympiques et paralympiques de Paris en 2024, le programme de recherche Sciences 2024 touche à son terme. En attendant les résultats des délégations françaises, il aura permis de rapprocher durablement sport et science.
En 2018, Christophe Clanet, directeur de recherche au CNRS, annonçait dans les colonnes de CNRS Le Journal le lancement d’un programme de recherche inédit : Sciences 2024. Initié en prévision des Jeux olympiques et paralympiques (JOP) de Paris en 2024, ce programme, le premier en France mêlant aussi fortement sport et science, a explicitement pour objectif d’accroître le nombre de médailles obtenues par les délégations françaises. Six ans après sa naissance et quelques mois avant les JOP, qu’est devenu Sciences 2024 ? quels en ont été les fruits ? et quel en sera l’héritage une fois les Jeux passés ?
Force est de constater le premier mérite du programme : « mettre les sciences dures au service du sport élite », comme s’en réjouit Christophe Clanet, son directeur. Si quelques initiatives individuelles existaient par le passé, il n’existait pas, en France, de programme aussi ambitieux et structuré porté au plus haut niveau de l’État – dans le cadre de Sciences 2024, par une quinzaine de grandes écoles, des organismes de recherche nationaux – le CEA, le CNRS et l’Inria – et des institutions sportives – l’Institut national du sport, de l’expertise et de la performance et le Centre national des sports de la Défense. Christophe Clanet salue le rôle de pilote joué par l’État : « Sans l’État et l’ANR, il n’y aurait pas eu de financement de la recherche sur le sport élite ». Ce faisant, l’initiative vise à rattraper le retard du pays par-rapport aux autres grandes nations sportives. Comme le constate Christophe Clanet, « les nations qui performent le plus en sport sont aussi celles qui font de la recherche sur le sujet : les États-Unis, la Chine et le Royaume-Uni sont de fait celles qui publient le plus dans ce domaine ». Doté d’un budget de 20 millions d’euros sur cinq ans, le programme prioritaire de recherche (PPR) Sport de très haute performance a financé, via l’ANR et le Programme Investissements d'avenir 3, douze projets à l’échelle nationale. Les équipes scientifiques de Sciences 2024 se sont impliquées dans cinq d’entre eux : « Neptune » pour la natation, « CtoOr » pour la voile, « REVEA » pour la boxe et la gym, « THPCA » pour le cyclisme et l’aviron et « Paraperf » pour les disciplines paralympiques. En plus de ces projets nationaux, les équipes de Sciences 2024 ont aussi répondu aux demandes d’autres fédérations sportives : équitation, tennis de table, athlétisme et badminton. Les équipes scientifiques associées se sont ensuite réparties les différents volets du PPR : préparation mentale des sportifs, utilisation de vidéos et d’outils d’intelligence artificielle, etc.

La recherche au service des équipes de France
À la différence de la recherche fondamentale, la recherche appliquée aux JOP se veut donc utilitaire, tournée vers le court terme et le service des équipes sportives. Rémi Carmigniani, ingénieur du corps des Ponts, Eaux et Forêts et chercheur à l’École des Ponts ParisTech au sein du Laboratoire d’Hydraulique Saint-Venant, en sait quelque chose. Cet ancien nageur de bon niveau, impliqué dans le projet NEPTUNE du PPR, s’est intéressé à l’amélioration de la performance des nageurs français via l’apprentissage et l’optimisation du geste sportif. Loin d’être hors-sol, ses travaux visaient à « transformer les expertises de terrain en expertises scientifiques et à quantifier l’œil de l’entraîneur ». Élizabeth Colin, enseignante-chercheuse à l’Efrei dont elle est référente scientifique pour Sciences 2024, confirme ce nécessaire transfert d’un savoir empirique vers un savoir scientifique : « nous avons besoin de temps pour traduire les problématiques du terrain en problématiques scientifiques ».
Le temps : tel est bien le défi majeur que doivent relever les scientifiques immergés dans un monde sportif où le temps dévolu à l’entraînement et aux compétitions des sportifs est précieux. Dans cette optique, les membres de Sciences 2024 s’adaptent aux contraintes des sportifs. Dans ses études en collaboration avec la Fédération française de natation, Rémi Carmigniani a ainsi mis en place des retours rapides, au bord du bassin, pour confirmer ou infirmer les ressentis de l’entraîneur et des nageurs. Au demeurant, ces contraintes apportent aussi leur lot de challenges scientifiques. Le chercheur des Ponts trouve ainsi un grand intérêt, en tant que physicien modélisateur, à une science qu’il juge « sur-mesure, dans laquelle on adapte les modèles à chaque athlète », comme par exemple Maxime Grousset, médaillé d’or en 100 mètres papillon aux derniers championnats du monde de natation. Face au sentiment général de plaisir au travail des membres de Sciences 2024, Christophe Clanet juge l’objectif initial réussi : « on est là où l’on voulait être : au quotidien avec les entraîneurs ».

L’héritage scientifique des JOP
À présent qu’approchent de manière imminente les JOP, quel avenir pour la recherche sur le sport ? Les acteurs de Sciences 2024 sont unanimes : quels que soient les résultats des équipes françaises, l’initiative aura contribué à rapprocher des mondes qui, jusqu’alors, ne se parlaient pas. Faten Chakchouk, professeure à l’Efrei et directrice d’une thèse sur la caractérisation de l’allure des chevaux par analyse vidéo au moyen de l’intelligence artificielle, inscrite à Sciences 2024, confirme que le programme « a ouvert une passerelle ». Son doctorant, Benoît Pasquiet, par ailleurs ingénieur de recherche à l’Institut français du cheval et de l’équitation (IFCE), confirme ce rapprochement avec son institution d’origine, plutôt ancrée dans le monde sportif : « Sciences 2024, en ouvrant des partenariats avec de grandes écoles, nous a permis de découvrir des possibilités techniques que nous ne maîtrisions pas, comme le traitement de données par machine learning, afin de réaliser des analyses plus poussées du mouvement sportif ». L’IFCE avait ainsi sollicité l’appui de l’Efrei et son expertise des datas car il « coinçait sur un plan technique, faute de compétences adaptées ». La réussite de tous ces partenariats tient à l’adoption par les parties en présence d’un vocabulaire commun en vue d’un objectif partagé : l’amélioration des performances sportives. Au terme de ces collaborations, nombre d’acteurs sportifs ont fini par apprécier le rôle spécifique des scientifiques au sein de leurs équipes, à l'instar de Rémi Carmigniani qui considère ses travaux comme des « aides à la décision » au service de l’entraîneur.
Ainsi, loin de s’achever avec les JOP, quantité de projets nés dans le cadre de Sciences 2024 vont se poursuivre dans les années à venir. Entre l’Efrei et l’IFCE, de nombreux chantiers de recherche sur l’usage des datas en équitation sont encore à ouvrir. Car, au-delà de l’analyse du geste technique les outils informatiques pourraient permettre, selon Benoît Pasquiet, de mieux comprendre « la fatigue, la blessure, le comportement, voire certains signaux d’alerte des chevaux ». Rémi Carmigniani insiste pour sa part sur l’appropriation par la Fédération française de natation de ses recherches et des outils d’analyse qu’il a développés afin de faciliter l’entraînement des futures générations de nageurs et nageuses : « on a la chance de pouvoir travailler avec les meilleurs mondiaux, comme Maxime Grousset, afin de construire des modèles physiques de qualité qui ruisselleront sur les générations futures. Tout notre intérêt, c’est l’héritage ».

En définitive, les résultats sportifs des délégations françaises importeront peu, tant les relations nouvelles entre sport et science ne sont pas prêtes de s’éteindre. Peut-être même que le rêve de Christophe Clanet s’accomplira, lui qui espère voir Sciences 2024 et son héritage « devenir l’équipe de France de la recherche ».
Le CNRS pilote le GDR Sports et activités physiques
Au-delà du soutien de l’organisme au projet Sciences 2024 sur la haute performance, une autre initiative fédérative sur le sport a été initiée par le CNRS, qui a créé en 2018 le Groupement de recherche (GDR) Sports et activités physiques. Ce GDR a pour vocation de fédérer l’ensemble des acteurs dans une perspective de recherche pluri- et interdisciplinaire non seulement autour des sports mais également des activités physiques. Après cinq premières années dédiées principalement à la construction et à l’animation du réseau, le CNRS a demandé à la Mission pour les initiatives transverses et interdisciplinaires de porter la deuxième phase du GDR autour de quatre nouveaux axes de recherche : « Facteurs humains et sociaux de la haute performance », « Sports, santé et bien-être », « Sports et éducations » et « Sports, territoires et emplois ».


