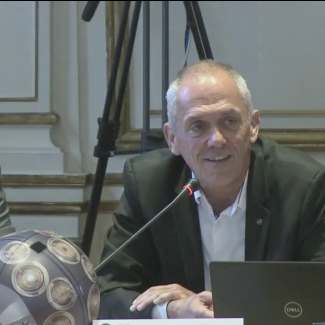Le CNRS, acteur clé pour les décideurs
Réunion de la Commission des affaires culturelles et de l'éducation de l’Assemblée nationale et 40 ans de l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques : retour sur deux événements qui démontrent le rôle du CNRS auprès des décideurs.
Une « séquence importante qui montre l’engagement du CNRS au service de la société, et notamment de l’aide à la décision publique et à la compréhension ». Voilà comment Antoine Petit, président-directeur général du CNRS, présente les deux événements qui ont ponctué la fin du mois de juin et le début de ce mois de juillet.
Le 28 juin d’abord, le CNRS a accueilli, comme il l’avait fait en 2019 lors des 80 ans de l’organisme, la réunion de la Commission des affaires culturelles et de l’éducation de l’Assemblée nationale. Créée en 2009, celle-ci s’intéresse à l’enseignement scolaire, l’enseignement supérieur, la recherche, la jeunesse, les sports, les activités artistiques et culturelles, la communication et la propriété intellectuelle. Dans le sillage de leur présidente Isabelle Rauch, une majorité des 72 députées et députés qui la composent ont ainsi pu rencontrer le collège de direction de l’organisme. L’occasion d’échanger sur des sujets aussi variés que la pluridisciplinarité du CNRS et son interdisciplinarité – par la voix des directeurs et directrices des 10 instituts –, ses cibles prioritaires que sont les enjeux sociaux, la valorisation de la recherche et son transfert vers le monde économique ainsi que l’aide à la compréhension et à la décision, ou encore son ouverture à l’international et son ancrage territorial. Durant trois heures, scientifiques et politiques ont ainsi pu interagir librement, jetant les bases de potentielles futures collaborations. « Les services de la Commission m’ont indiqué que les présentations avaient séduit l’auditoire et alimenté chez les parlementaires présents la volonté d’aller plus loin en visitant nos laboratoires. », témoigne Thomas Borel, responsable des Affaires publiques au CNRS.
C’est également pour mettre en avant « le lien fort entre la science et la politique » que l'Assemblée nationale et le Sénat ont organisé conjointement plusieurs manifestations les 5 et 6 juillet, dans le cadre des 40 ans de l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques (Opecst). Créé en juillet 1983 – il fut le premier outil de ce genre en Europe –, l’Opecst a pour rôle d’éclairer les commissions constitutionnelles de l’Assemblée nationale et du Sénat sur les enjeux scientifiques des sujets qui doivent être traduits en termes politiques. Composé de 18 députés et 18 sénateurs, il a déjà adopté près de 250 rapports et 40 notes scientifiques, accessibles en ligne.

Dans ce cadre, une exposition sur « L’Opecst, 40 ans de science au Parlement » a été élaborée dans la Galerie des fêtes de l’Assemblée nationale. Elle est accessible au public du 7 au 13 juillet dans le cadre des visites organisées par l’Assemblée nationale. Le CNRS est évidemment présent sur cette exposition, aux côtés de ses partenaires comme Universcience, l’Inserm ou encore l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire (IRSN). Il propose des présentations et démonstrations autour de la robotique et de l’intelligence artificielle, des applications pour la santé et le développement durable jusqu’à la robotique sociale et la voiture autonome. « Les relations que nous avons construites de longue date avec l’Opecst – notre organisme concoure très souvent à ses travaux – nous conduisent régulièrement à participer à la co-construction de ce type d’événement. En l’espèce, nous nous sommes faits un plaisir de répondre positivement à la proposition thématique qui nous avait été faite. », détaille Thomas Borel, avant de conclure : « S’il est difficile d’en évaluer les apports à long terme, le CNRS pourra, comme il le fait de mieux en mieux, capitaliser sur les interactions individuelles et collectives qui ont pris place lors de cette séquence. »