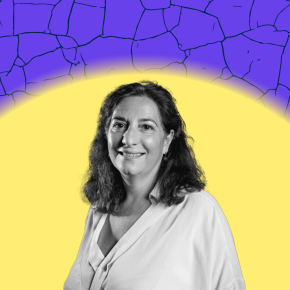« Nous espérons accompagner l’émergence de clusters SHS sur des thèmes communs »
Marie Gaille, directrice de CNRS Sciences humaines & sociales revient sur les dynamiques actuelles des SHS en Europe et en France, qui connaissent un nouvel essor. Focus sur les succès récents et des initiatives comme l’AMI SHS publié par France 2030, qui visent à structurer et valoriser les recherches en SHS, tout en répondant aux grands défis sociétaux.
Les SHS étaient peu représentées dans les appels à projets européens, mais elles ont récemment gagné en visibilité, avec de nombreux lauréats du Conseil Européen de la Recherche (ERC). Qu’est-ce que cela symbolise en termes de dynamique des SHS au sein de la recherche ?
Marie Gaille : C’est une dynamique de succès. J’espère que 2024 est une année appelée à se reconduire en termes de succès à l’Europe – à ce stade de l’année, mentionnons les Advanced ERC1 , plusieurs sélections pour les oraux des ERC Synergy2 qui auront lieu en septembre, le projet ECHOES, porté par le CNRS et son homologue italien le CNR, qui a obtenu 25 millions d’euros en vue d’élaborer un outil sur les données patrimoniales au service des musées comme des acteurs de la recherche, et le public élargi. Il est crucial de consolider ces réussites et surtout d’accompagner les démarches qui trouvent dans les formats des appels à projets européens le bon cadre pour répondre à leurs questions de recherche.
Quelles stratégies spécifiques peuvent être mises en place pour encourager la collaboration et l’élaboration collective de propositions de recherche en SHS, et comment ces nouvelles dynamiques peuvent-elles transformer la manière dont les établissements de recherche abordent les appels à projets ?
M. G. : Les SHS n’ont sans doute pas assez l’habitude de se penser collectivement et de se constituer en force de propositions via des consortia, par différence d’autres communautés scientifiques. Des initiatives telles que les programmes nationaux ou le nouvel appel à Manifestation d’Intérêt (AMI) intitulé « Programmes de recherche en sciences humaines et sociales » (SHS) contribuent à faire émerger et conforter cette habitude. Cet appel SHS France 2030 a été l’occasion d’un dialogue intense, multiple, et dont on peut penser qu’il est à même de faire naître ou de renforcer de nouvelles pratiques et relations entre établissements, à mon sens vertueux dans le contexte contemporain de financement public de la recherche (sur AAP). Au risque de me répéter, il nous faut faire entrer dans nos habitudes l’élaboration collective de programme de recherche, avant même la publication des appels, être dans l’anticipation, la proposition, notamment via la création de réseaux de recherche.
Pouvez-vous nous en dire plus sur l’AMI SHS ? Comment l’appel - qui s’adresse aux universités et établissement - s’inscrit-il dans cette logique de collaboration que vous préconisez ?
M. G. : L’AMI invite universités et établissements à développer leur « signature » en se positionnant sur l’une des neuf thématiques identifiées dans l’appel3 . Lors d’une première phase, ils ont répondu sous forme de lettres d’intention, visant à identifier leurs « signatures » et ont constitué des consortia de recherche, devant inclure au moins un organisme national de recherche. Nous attendons l’issue de la sélection des consortia qui seront invités à déposer un projet complet à l’automne.
L’action a permis à chacun de réfléchir à son positionnement national, facilitant ainsi de futures collaborations. Au niveau international, il vise sans aucun doute le fait de renforcer la position des SHS françaises. Si je m’en tiens au niveau européen, nous espérons que cela favorisera l’émergence de clusters SHS sur des thèmes communs et soutiendra la capacité à porter des équipes à l’échelle européenne pour des dépôts de projet ERC, de réseaux ou encore collaboratifs. Cette initiative contribue également à la construction de la recherche SHS en France. CNRS Sciences humaines & sociales promeut une approche par objet, tant il est vrai que de nombreuses questions de recherche doivent être abordés en pluridisciplinarité, à travers des laboratoires pluridisciplinaires et des réseaux nationaux. L’AMI est idéal sous cet angle ; il invite d’emblée à transcender les barrières disciplinaires.
L’appel vise à répondre à de grands défis sociétaux ; comment les sciences humaines et sociales se mobilisent-elles ?
M. G. : Les projets découlant de l’AMI devront proposer des transferts de connaissances aux niveaux étatique et local, et joueront donc un rôle pour l’aide à la décision pour les pouvoirs publics mais aussi à destination des acteurs socio-économiques.
Neuf thématiques ont été identifiées, reflétant à la fois des enjeux nationaux et internationaux d’actualité. Parmi celles-ci, on retrouve « JO et impact du sport sur la société », particulièrement pertinente à l’aube de Paris 2024, mais quand je parle d’actualité, je l’entends au sens large et structurant pour « notre époque ». Ainsi, la thématique « Civilisations et crises géopolitiques », fait écho aux troubles géopolitiques actuels, aux foyers de conflits qui ont des répercussions pour tous, aux enjeux de mondialisation/démondialisation, etc. ; la thématique « Conséquences du changement climatique » et celle relative à l’évolution des habitats et des modes de vie renvoient aux enjeux de la transition environnementale. D’autres thématiques, telles que « Évolution des démocraties », « Les âges de la vie » et « La question du travail », sont des enjeux de société évidents liés aux difficultés de divers ordres que rencontrent les régimes démocratiques, les transitions démographiques, les évolutions des formes du travail et de son organisation. Ce sont des objets très étudiés, renvoyant à des communautés de recherche pluridisciplinaires importantes et visibles. La thématique « Préservation du patrimoine culturel » mérite également une mention spéciale, étant particulièrement soutenue aux niveaux national et européen, avec des communautés de recherche françaises reconnues internationalement. La thématique « religions », qui peut être envisagée sous divers angles (comme objet politique, comme pratique sociale multiple et diverse, sous l’angle théologique, etc.), fait également partie de cet éventail de questions de recherche mis en avant par l’AMI. CNRS Sciences humaines & sociales a pu travailler avec les porteurs de consortium sur chacune des neufs thématiques, en s’impliquant notamment sur celles qui renvoient à nos communautés et à notre positionnement stratégique.
Le CNRS s’est impliqué avec 28 universités pour cette action. Comment l’organisme a-t-il réfléchi à son positionnement et son apport ?
M. G. : L’équipe de direction scientifique de CNRS Sciences humaines & sociales a interagi avec chaque université porteuse de consortium souhaitant intégrer le CNRS. Tout en considérant, avec nos partenaires, leur positionnement respectif, nous avons réfléchi en interne à la contribution spécifique du CNRS. Nous avons opté pour assumer un rôle dans la suite logique de notre politique scientifique et avons axé notre participation sur le circuit de la donnée, et/ou la valorisation des résultats scientifiques et les enjeux d’innovation sociale, et/ou l’accompagnement des actions internationales du projet, et/ou le soutien à des réseaux nationaux ou internationaux en lien avec le projet. C’était à la carte et chaque implication a été discuté avec le consortium.
Nous avons discuté avec une cinquantaine d’universités et d’établissements et nous nous sommes finalement impliqués avec 28 d’entre eux, en veillant à ne pas être présents dans des projets qui étaient trop proches les uns des autres, ou chevauchaient les thématiques financés par d’autres outils de France 2030 dans des programmes (co-)portés par le CNRS, ; nous avons aussi veillé à la logique de nos relations partenariales déjà fortes – ou plus rarement, à développer - sur le thème retenu par tel ou tel porteur de consortium.
- 1Ces bourses permettent à des scientifiques, reconnus dans leur domaine aux niveaux national et international, de mener des projets novateurs à haut risque qui ouvrent de nouvelles voies dans leur discipline ou dans d’autres domaines. Visant des chercheurs confirmés, ces bourses se situent à un niveau d’expérience plus élevé que les bourses « Starting » (jusqu’à 1,5 million d’euros et visant des porteurs et porteuses de projets européens ayant obtenu leur doctorat 2 à 7 ans auparavant) et « Consolidator » (jusqu’à 2 millions d’euros et 7 à 12 ans après le doctorat).
- 2D’une durée de 6 ans et d’un montant maximal de 10 millions d’euros, ces bourses sont conçues pour permettre à des groupes de 2 à 4 scientifiques, de pays membres ou associés, de s’attaquer à certains des problèmes de recherche les plus redoutables du monde, qui couvrent plusieurs disciplines scientifiques.
- 3Les neufs thématiques de l’appel : Évolution des démocraties ; La question du travail ; Les âges de la vie ; Religions ; Civilisations et crises géopolitiques ; Conséquences du changement climatique ; Évolution des habitats et des modes de vie ; Préservation du patrimoine culturel ; L’impact social et sociétal de la pratique sportive
Les sciences humaines et sociales présentes au sein de programmes nationaux de recherche
Le CNRS co-porte le volet recherche de la Stratégie nationale d’accélération1 Industries culturelles et créatives, le Programme et équipements prioritaires de recherche2 (PEPR) d’accélération ICCARE, avec un pied dans les SHS et un pied dans les sciences de l’informatique ; le PEPR Transform, sélectionné en 3èmevague, qui s’inscrit dans un intérêt pour les recherches sur l’habitabilité de la planète, et s’appuie sur un triptyque sciences de la terre et de l’univers-sciences de l’écologie et de l’environnement-sciences humaines et sociales. C’est, au sens large, également la question de l’habitabilité de la planète qui rend compte de l’implication de CNRS Sciences humaines et sociales dans plusieurs PEPR exploratoires ou d’accélération : en premier lieu, le PEPR IRiMa, sur la science du risque et et le PEPR Villes durables et bâtiments innovants, ainsi que les PEPR Sous-sol et le Recyclage. « Ces derniers inscrivent les SHS dans des questionnements interdisciplinaires », souligne Marie Gaille. L’implication de l’institut dans Robotique organique (O2R) renvoie à sa priorité dédiée aux transitions numériques ; et pour les PEPR non pilotés par le CNRS, sa priorité dédiée à la santé rend compte de son implication forte au sein du PEPR Santé et numérique piloté par l’Inserm et l’Inria. Il faut enfin mentionner les Programmes prioritaires de recherche3 Autonomie et Sciences pour l’éducation. « Notre présence, souvent en collaboration avec d'autres domaines disciplinaires, est significative », indique Marie Gaille.
- 1Les stratégies d’accélération sont au cœur du quatrième Programme d’investissements d’avenir (PIA4) dont les grandes lignes ont été annoncées par le Premier ministre en septembre 2020 à l'occasion de la présentation du plan France Relance. À travers ces stratégies d'accélération, il s’agit d’identifier les principaux enjeux de transition socio-économique de demain et d’y investir de façon exceptionnelle et massive dans une approche globale.
- 2Les programmes et équipements prioritaires de recherche (PEPR) visent à construire ou consolider un leadership français dans des domaines scientifiques liés à une transformation technologique, économique, sociétale, sanitaire ou environnementale et considérés comme prioritaires au niveau national ou européen. Ces programmes, opérés par l'Agence nationale de la recherche (ANR), sont de deux types : les PEPR de stratégie nationale d’accélération – qui accompagnent des transformations déjà engagées et les PEPR exploratoires – qui ont vocation à développer des secteurs émergents.
- 3Les PPR (Programmes prioritaires de recherche) sont les précurseurs des PEPR. Ils sont financés dans le cadre du programme investissements d’avenir (PIA3).
Les dispositifs de l’appel à Manifestation d’Intérêt « Programmes de recherche en sciences humaines et sociales »
L'AMI SHS, porté par le Secrétariat général pour l’investissement (SGPI) et le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche (MESR), a été lancé en mars 2023. Les résultats de la première phase seront connus en juillet 2024, avec des projets complets à déposer en octobre 2024 pour un lancement en 2025. Les projets lauréats bénéficieront d’un financement minimum de 5 millions d’euros sur des projets de 8 ans, visant à structurer et valoriser les sciences humaines et sociales en France dans le cadre du plan de financement France 20301 .
- 1Présenté par le président de la République le 12 octobre 2021, France 2030, un plan d’investissement inédit de 54 milliards d’euros, incarne la volonté de placer la France dans le peloton de tête sur une dizaine de secteurs stratégiques comme l'énergie, la santé du futur, la décarbonation de l’industrie ou encore l’alimentation et l’agriculture…