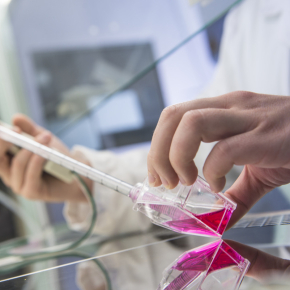La France, vivier d’innovation en oncologie
3,8 millions de personnes vivent avec un diagnostic de cancer en France. Une maladie en progression, mais touchée par des progrès thérapeutiques révolutionnaires. Et l’hexagone regorge de pépites françaises en oncologie issues de la recherche académique. État des lieux.
Alors que plus de 430 000 cas de cancers sont déclarés chaque année en France – un nombre multiplié par deux depuis 1990 – l’espérance de vie des malades n’a fait, lui, qu’augmenter ces trente dernières années. Une conséquence de l’amélioration patente du diagnostic du cancer, mais aussi de traitements de plus en plus innovants mis sur le marché.
Aussi, rien qu’en Europe, 5 millions de vies ont pu être sauvées grâce à ces progrès technologiques, selon l’Office européen des brevets, qui pointe une hausse de plus de 70% des inventions dans la lutte contre le cancer entre 2015 et 2021. Une course à l’innovation dans laquelle la France trouve une place de choix, arrivant, en 2023, à la troisième place des pays du vieux continent les plus innovants en oncologie.
Du laboratoire de recherche au produit
Excellence de la recherche académique et montée en puissance de start-ups toujours plus créatives : « la France reste aussi le 5e pays d’Europe le plus attractif pour les investisseurs », confirme la Dr Lise Alter, directrice générale de l’Agence de l’innovation en santé, fraichement créée (fin 2022) pour accompagner les porteurs de projets autour de l’innovation médicale et accélérer et simplifier le développement des innovations.
L’idée de l’Agence ? Favoriser le passage à l’échelle, « en assurant un continuum entre la recherche en amont et l’accès de la thérapie au patient », détaille Lise Alter. Une période parfois longue, qui prend souvent racine dans un laboratoire de recherche académique et nécessite des financements à chaque étape du transfert de technologie et que l’État entend accompagner. « Dans le cadre de France 2030, nous disposons par exemple de 80 millions d’euros sur 5 ans pour les chaires d’excellence en biologie-santé », illustre la directrice générale de l’Agence de l’innovation en santé.
Guider le médicament
Professeur de chimie organique à l’Université de Poitiers, Sébastien Papot s’est lui lancé dans la course contre le cancer il y a près de 20 ans. À l’Institut de Chimie de Milieux et Matériaux de Poitiers (CNRS/Université de Poitiers), « notre idée était d’abord de développer des robots moléculaires capables d’effectuer des tâches de manière autonome dans les milieux biologiques », se souvient-il. Un challenge qui a abouti à la naissance de la programmation moléculaire, « avec pour application le traitement sélectif des cancers », souligne le chercheur.
Alors que la chimiothérapie anticancéreuse est toxique à la fois pour les cellules tumorales, mais aussi pour les cellules saines - entraînant des effets indésirables importants - l’objectif de Sébastien Papot était de développer des molécules capables de détecter uniquement la tumeur pour délivrer le médicament au bon endroit, épargnant les tissus sains. « Nos molécules sont programmées pour reconnaître le microenvironnement tumoral et pour ne libérer l’agent anticancéreux qu’au sein de la tumeur », résume Sébastien Papot.
Elles reconnaissent ainsi des enzymes qui sont surexprimées dans un très grand nombre de cancers. « Ce sont des enzymes identifiées depuis la Seconde Guerre mondiale comme étant un marqueur des cancers solides, mais personne n’avait réussi jusqu’alors à les cibler de manière efficace », rembobine Sébastien Papot.
Sortir de la preuve de concept
Si les thérapies ciblées anticancéreuses ne sont pas nouvelles – les anticorps conjugués existent déjà depuis une quinzaine d’années – « ces derniers ciblent directement les cellules cancéreuses qui sont très hétérogènes au sein d’une même tumeur et qui présentent une grande variabilité interindividuelle », souligne Sébastien Papot, qui précise ainsi que son innovation développée à Poitiers « s’affranchit de cette hétérogénéité pour cibler la plupart des tumeurs solides ». Résultat : une même molécule pourra traiter un très grand nombre de patients de manière ciblée, qu’il s’agisse de cancer du poumon, du sein ou du pancréas par exemple.
Mieux : l’équipe de recherche est allée plus loin en concevant une sonde capable de détecter la présence de cette enzyme chez les patients. « C’est un concept que nous avons inventé avec le docteur Pauline Poinot : la volatolomique induite », poursuit le chercheur. « Ces sondes libèrent des composés volatils au contact de la tumeur et, lorsque le patient expire de l’air, son haleine est analysée pour établir un diagnostic ».
Fort de ces innovations, Sébastien Papot, en s’associant avec Oury Chetboun, crée en 2018 sa start-up, Seekyo, afin de transférer ces travaux académiques vers la clinique. Pour l’heure, « nous en sommes aux études précliniques et nous essayons de réaliser une levée de fond pour des essais chez l’homme », ajoute le chercheur, qui évoque « un succès pluridisciplinaire, fruit de l’excellence académique ». Aussi, « la création d’une structure privée comme Seekyo est extrêmement importante pour sortir de la preuve de concept que sont les résultats académiques, et aller vers la R&D », tient à souligner Sébastien Papot qui a également bénéficié d’accompagnement de Bpifrance.
Restaurer une réponse immunitaire
À Montpellier, c’est en 2007 que Ludovic Clarion – chimiste organicien lui aussi – termine sa thèse CNRS. Ses travaux avaient permis de développer une nouvelle famille de composés, avec pour ambition initiale « de limiter le caractère invasif et la migration des cellules afin d’éviter le risque de métastase. Nous nous sommes alors rendu compte qu’ils étaient également capables d’inhiber la croissance tumorale in vitro », se souvient Ludovic Clarion, CSO-cofondateur de Phost’in Therapeutics
En 2014, après un parcours de maturation, « il a fallu aller plus loin et créer une entreprise pour transformer ces molécules en médicament pour les patients », poursuit Ludovic Clarion. Phost’in Therapeutics est né.
La cible thérapeutique de ce nouveau candidat médicament ? L’enzyme GnT-V, déjà connue, mais inhibée pour la première fois grâce aux travaux académiques de Ludovic Clarion. Un mécanisme « totalement innovant », poursuit d’emblée le chercheur, qui permet de perturber les cellules tumorales à plusieurs niveaux, « en diminuant leur capacité à migrer et proliférer, en affectant leur métabolisme et en restaurant une réponse immunitaire efficace ». Une thérapie ciblée – « GnT-V n’est active que dans les cellules malades et le traitement n’affecte pas les cellules saines », précise Karine Chorro, CEO de Phost’in Therapeutics.
Ces inhibiteurs de N-glycosylation s’adressent à « tout type de tumeurs solides », souligne encore Karine Chorro. Un premier essai clinique est en cours, avec 15 patients déjà traités souffrant de tumeurs agressives solides, dont des cancers des ovaires, du pancréas ou des glioblastomes, l’un des cancers du cerveau les plus fréquents chez l’adulte. Autre avantage du candidat médicament ? « Le traitement est administré sous forme buvable, très important pour la qualité de vie des patients, qui sont traités à domicile », tient à souligner Ludovic Clarion.
La jeune pousse issue de la recherche académique a été incubée pendant sa première année à l’École nationale supérieure de chimie de Montpellier et exploite un portefeuille de brevets CNRS. Depuis sa création, Phost’in Therapeutics a levé environ 18 millions d’euros dont plus de 4 millions en financement de Bbifrance entre 2020 et 2024. « Nous avons aussi signé une option de licence exclusive avec la multinationale japonaise Taiho Pharmaceutical pour l’exploitation de notre candidat médicament au Japon et en Asie (Chine exclue) », indique Karine Chorro.
Booster le système immunitaire dans les tumeurs froides
Autre exemple : après près de 40 ans de recherche, Hephaistos-Pharma, créée en 2018, entend s’attaquer à des cancers incurables. La start-up associe l’expertise du Centre de recherche en cancérologie de Lyon (CNRS/Inserm/Université Claude Bernard/Centre anticancéreux L. Berard) et les travaux de Martine Caroff, chercheure CNRS. Elle a développé un immunostimulant, "ONCO-Boost", capable de transformer des tumeurs froides - qui passait jusqu’alors sous le radar du système immunitaire entrainant un échec thérapeutique chez les patients - en tumeurs chaudes, favorisant une réponse immunitaire.
En préclinique, les résultats sont encourageants : guérison totale de 20 % à 100 % pour les lymphomes et 78 % pour l’ostéosarcome. Des essais cliniques sont prévus d’ici deux ans.
Programme de prématuration au CNRS
« Depuis quelques années, il y a un dynamisme qui s'est accéléré avec la mise en place de la part des différents acteurs académiques comme le CNRS d'outils pour accompagner les innovations et les innovations thérapeutiques en bénéficient », confirme André Le Bivic, Directeur de CNRS Biologie. Depuis 1999, ce ne sont pas moins de 500 start-up en santé issues du CNRS qui ont vu le jour.
Pour aider les découvertes réalisées dans des laboratoires de CNRS Biologie à passer vers l’innovation thérapeutique, le CNRS a notamment mis en place « un programme de prématuration qui finance à hauteur de 150 000 euros un projet original pour l’amener vers des TRL plus élevées (de 1 à 3) », souligne André Le Bivic. Des dizaines de projets ont ainsi pu être soutenus, dont près de la moitié ayant une thématique biotech/medtech en 2023.
Au-delà d’une sensibilisation accrue des chercheurs CNRS à l’innovation, « la mise en place des PEPR (qu'ils soient d'accélération ou exploratoires), par l'impulsion du gouvernement, touchant le domaine de la santé montre une volonté de mettre l'accent sur ces thématiques et d'approfondir les relations entre les acteurs académiques travaillant sur ces domaines », fait encore savoir le directeur de CNRS Biologie, citant par exemple la stratégie d’accélération en bioproduction ou encore, de produits issus du vivant pour les nouvelles thérapies.
Pour aller un cran plus loin dans les années à venir, le CNRS envisage ainsi « d’accélérer encore dans le transfert des résultats des laboratoires en le détectant plus rapidement et en trouvant des partenaires industriels grâce à l’embauche d’ingénieurs spécialisés dans ces domaines », précise André Le Bivic. Le déploiement d’une centaine de ces ingénieurs est déjà prévu pour mailler l’ensemble du territoire.
Un vivier qui intéresse l’industrie pharmaceutique
Sans surprise, l’excellence de la recherche académique française fait de l’œil à l’industrie pharmaceutique. Directrice Early Innovation Partnering France chez Johnson & Johnson, Siau Bai est chargée de sourcer les innovations qui naissent dans l’Hexagone, « de la recherche académique jusqu’à des projets au stade de preuve de concept clinique », raconte-t-elle, précisant qu’elle « interagit régulièrement avec l’ensemble des SATT et les structures de valorisation des organismes de recherche comme Inserm Transfert, CNRS innovation, AP-HP transfert, l’Institut Pasteur ».
Le groupe américain s’appuie dans sa démarche sur des centres d’innovation, « qui vont être en charge d’établir des collaborations et des licences des programmes « early stage » », précise Siau Bai, mais également un incubateur, le « JLabs EMEA », capable d’accélérer la maturation des start-up, d’offrir un réseau, mais aussi des investisseurs. Aussi, « nous avons un modèle d’incubation "en virtuel" pour les start-up qui veulent rester en France », souligne Siau Bai. J&J dispose par ailleurs d’un fonds corporate stratégique, Johnson & Johnson Innovation JJDC Inc., - l’une des plus anciennes sociétés de venture capital au monde - qui investit dans le capital des start-ups, de sociétés de biotechs ou de medtechs, du stade seed-funding jusqu’aux séries A et B.
L’industriel américain a su nouer des partenariats en oncologie en France, notamment une collaboration de recherche sur les tumeurs solides, avec l’Institut Curie, « avec lequel nous avons conclu un accord-cadre stratégique pour une durée de 5 ans ». Récemment, un accord de licence mondial a été signé en 2023 entre Janssen Pharmaceutia NV, une société du groupe Johnson & Johnson, et la société de biotechnologie Nanobiotix, dont le siège social est situé à Paris, pour le NBTXR3, un amplificateur de radiothérapie expérimental, en phase clinique. « Le NBTXR3 est en cours d'évaluation dans plusieurs études portant sur diverses tumeurs solides, notamment dans le traitement des patients atteints de cancers localement avancés de la tête et du cou et en combinaison avec des inhibiteurs des points de contrôle immunitaires anti-PD-1 chez les patients atteints de cancers métastatiques », explique encore Siau Bai.
Une belle dynamique
Pour Siau Bai, « la France est excellente en termes de recherche académique, en nombre d’innovations, de publications scientifiques et de brevets ». De plus, « au cours des 10 dernières années, la France s'est classée parmi les 3 premiers pays de la région EMEA en termes de nombre de partenariats à un stade précoce chez J&J. Il y a un fort désir d'identifier de nouvelles opportunités de transformation à un stade précoce en France », souligne-t-elle, mettant en évidence « la très bonne dynamique » actuelle.
Un coup de boost poussé par France 2030 et la création de l’Agence de l’innovation en Santé, qui a déjà mis sur les rails des projets concrets autour de l’oncologie. « Par exemple, le Paris Saclay Cancer Cluster, financé par France 2030 avance très bien », illustre Lise Alter. Dans la même veine, l’Agence de l’innovation en Santé accompagne la naissance de l’IHU Prism au pied de Gustave Roussy, autour de la prise en charge précoce du cancer, ou encore de l’IHU cancer de la femme à l’Institut Curie.
1 à 5 millions d’euros sont également débloqués pour financer des chaires d’excellence « avec pour objectif à la fois de recruter des chercheurs juniors, de donner envie à des chercheurs d’excellence d’exercer sur le territoire national, et à d’autres de revenir », espère Lise Alter. 22 premiers lauréats ont été annoncés récemment. Le tout dans une stratégie d’accélération de la production de biomédicaments dans l’hexagone.
Simplifier !
L’idée derrière la création de l’Agence de l’innovation en santé est aussi « d’accélérer et de simplifier la naissance des innovations, en huilant bien tous les rouages de la chaine de valeur » tient à rappeler Lise Alter. « Nous cherchons également à sensibiliser les chercheurs autour des réglementations qui peuvent impacter le développement de ces technologies, d'autant que nous sommes à des stades assez amont de développement », poursuit pour sa part André Le Bivic.
Car, si la France fourmille d’innovations, certains porteurs de projet regrettent encore une « lourdeur administrative », à l’instar de Sébastien Papot. « La créativité de la recherche académique française est excellente pour faire naître des innovations, mais le transfert de technologie est encore compliqué », note le chercheur qui constate que « les levées de fonds en France sont 5 à 10 fois moins importantes qu’aux États-Unis ». Une difficulté que constate également Karine Chorro : « il n’y a pas assez de capitaux pour passer à l’industrialisation ».
C’est d’ailleurs forte de ce constat que l’Agence de l’innovation en santé entend aussi se positionner comme « un guichet unique, pour orienter les porteurs de projet en fonction de leur stade de maturité, en leur conseillant soit un incubateur, soit un pôle de compétitivité ou encore de rencontrer les autorités sanitaires pour passer en essais cliniques », illustre Lise Alter. Avec toujours le même objectif : « le développement de traitements innovants pour les patients ».